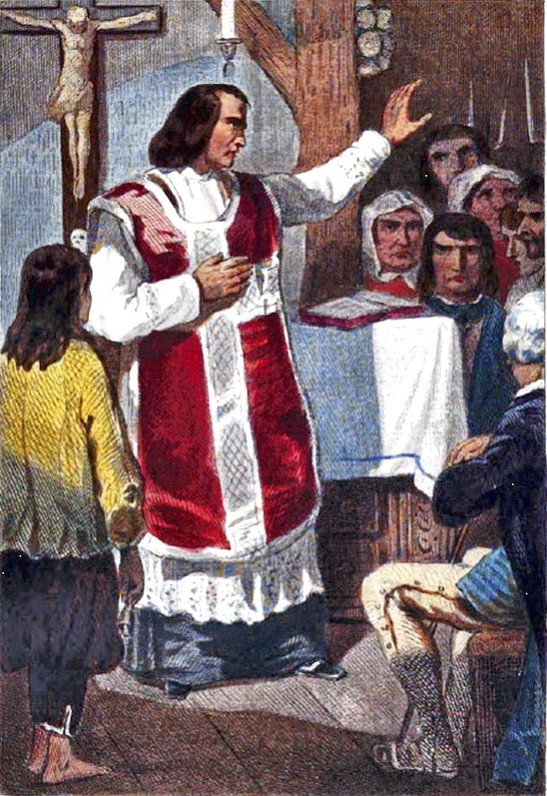L’appel a produit son effet : un lecteur a conservé le premier article publié dans le journal L’Alsace du samedi 15 octobre 1977 et me l’a communiqué ! Merci à Remy Moyses et son inépuisable bibliothèque ...
-o-o-o-
Les récentes découvertes le prouvent : Rouffach est plus ancien qu’on ne le pensait…
- Quelques rappels d’histoire…
Lors des travaux autour de l’église Notre-Dame de Rouffach, des découvertes ont été faites dont l’importance pour la connaissance du passé lointain de la ville mérite d’être soulignée. Depuis un bon nombre d’années, M. Paul Faust, archiviste de la ville, surveille et fouille chaque fois que l’occasion se présente. On soupçonnait bien la très haute antiquité de cette cité, ne serait-ce qu’en analysant son nom. Mais de soupçonner à prouver, il y a un grand pas qu’il n’est pas aisé de franchir. M. Faust réussit peu à peu à démontrer, grâce aux vestiges sortis du sol, que le site de la plus ancienne cité rubéacienne a une origine culturelle bien plus lointaine qu’on a pu le démontrer jusqu’à ce jour.
Par des voies différentes et nous fondant sur des considérations concernant l’évolution des paysages historiques, nous étions, dès 1559, arrivés aux mêmes conclusions. Mais revoyons ce que l’on pensait de l’histoire de Rouffach avant que l’idée de l’origine romaine n’ait repris le dessus dans les considérations.
L’historien et ancien maire de Rouffach, Thiébaut Walter, avait donc, au début du siècle précédent, classé les archives après avoir collaboré, dans les années 1890, à l’inventaire de celles de Kaysersberg. Ce travail l’occupait tout entier et plongé qu’il était dans la clarification de l’histoire médiévale, il était tout naturel qu’il ne pouvait que se ranger à l’avis de ses prédécesseurs, pour qui l’origine de la ville, en tant que telle, remontait à une époque où le site reconnu romain du fameux Bollenberg fut abandonné au profit de Suntheim et ensuite de Rouffach. En considérations des trouvailles de sarcophages et autres objets, personne ne pensait devoir remonter au-delà de la fin de la migration des peuples et de l’installation des Alamans et des Francs.
Nous avions en 1959 relevé certaines curiosités dans les textes dont la portée n'avait pas été suffisamment analysée avant cela. Dans l'acte de fondation d’Eschau, l’évêque Rémy donne au couvent bas-rhinois dans la ville de Robeaca: une cour, des vignes, des champs, des prés, un moulin etc. Nous sommes en 770 et dans cet acte il est question de l’opulence de la ville et des dîmes innombrables ainsi que des autels dans l'église. Rappelons-nous que par la victoire de Clovis, en 496, le christianisme n'a pas été introduit d'emblée chez les Alamans vaincus. Il ne s'est imposé dans leurs territoires qu'au cours et après le huitième siècle. Et pourtant, il est manifestement implanté dans certains sites comme celui dont il est question ici. Alors pourquoi ici dès cette époque et là plutôt qu’ailleurs ? Parce que le christianisme pouvait être, d’après ce que la science sait de ces héritages culturels, une survivance de l'époque antérieure aux migrations, c'est-à-dire gauloise ou gallo-romaine. Dès lors, pensons au fait que l'Eglise n'élevait ou n'entretenait des sanctuaires que là où existait une importante population, comme par exemple aux lieux de passage forcé comme c'était le cas à Strasbourg.
Un « lieu protégé »
Quelle importance pouvait donc avoir Rouffach à ce point de vue ? L’importance était effective. La découverte de tombes alamanes le prouve en ce qui concerne ces périodes de transition. Dès les années 1870-1880 on avait mis à jour dans l'ancien cimetière de nombreuses tombes que l'on jugeait alors être franques. Quant à l'importance comme lieu de passage, nous ne voulons pas trop nous aventurer. Mais nous renvoyons, malgré certains aspects discutables de la théorie de Jean Schlumberger [1] sur le lieu de la bataille d'Arioviste, à son ouvrage et ses considérations sur le chemin. Et curieusement il existe une nouvelle théorie émise par M. Edmond Walter qui situe la rencontre quelque part entre Rouffach et Brisach. Ce ne sont là pour nous que des indications. Il est certain qu’à l’époque de la bataille de César les chemins n'étaient pas ce qu'ils allaient devenir au temps des Romains. Mais pour quelqu’un qui venait de la trouée de Belfort, s'il suivait l’ancien chemin celte, il pouvait le plus facilement obliquer à partir de Rouffach vers le passage «protégé» et facile de Brisach s’il voulait traverser le Rhin, surtout à partir de fin juillet où les eaux du fleuve à cet endroit ne dépassaient guère 60 à 80 cm et où Arioviste avait fait passer ses peuplades. Lieu protégé à Brisach, bien protégé à Rouffach (Kastelberg) ? Peut-être !
Quoiqu'il en soit, aujourd'hui on admet que la donation du territoire de Rouffach par les rois d'Austrasie à l'évêque de Strasbourg date du milieu du 7ème siècle (675) où Dagobert Il (674-79) avait été relégué par Pépin d’Heristal dans ses « palais » en Alsace.
On est en droit de ce fait déjà d'admettre que la région de Rouffach le Mundat, la donation, avait primitivement une importance dont le souvenir s'est complètement évanoui au cours du millénaire suivant. Cette importance ne pouvait être qu'historique, c'est-à-dire léguée par le passé. Les occupants nouveaux, alamans ou francs, n'avaient aucune raison particulière pour vouloir inaugurer en ce lieu.
L'important nous semble donc avoir été le fait que de ce lieu partait, comme suggéré ci-dessus, une route issue du chemin celte vers Brisach (voir les considérations de Jean Schlumberger).
Heinrich Buttner [2], spécialiste de notre Histoire, écrit : « Ce n'est probablement pas un effet du hasard que ce soient précisément les noms de quelques établissements plus importants des Romains et quelques noms celtiques qui s'y soient maintenus. Bâle, Colmar, ... Rouffach, Kembs et Sierentz ont encore un nom préromain... L'état mérovingien et l'Eglise de ce temps semblent avoir pris pied le plus tôt en ces points de l'Alsace où avaient survécu le plus de restes de la répartition administratives des temps romains finissants »
C’est sous ce jour que l'on mesure l’importance des découvertes romaines faites dans le site étroit autour de la cathédrale de Rouffach. Que l’ensemble de la région ait eu son importance du temps romain, résultait jusqu'ici des trouvailles faites dans le site du fameux Bollenberg, dans la probabilité d'un « speculum», tour d'observation, « à la lsenburg » et autres détails (fouilles dans l'église des Récollets) etc.
Nous sommes cependant obligés de revenir sur une affirmation faite par les humanistes rubéaciens qui avaient une importante école à Rouffach. Ces érudits-là pouvaient encore parfaitement avoir eu connaissance de textes anciens disparus depuis lors.
« Bastie, l'an 914...»
Dans une étude sur l'Histoire de la ville, publiée en 1889, il est écrit:
«Quelques érudits ont voulu voir Rouffach dans le lieu-dit «Rouphiana», situé par Claude Ptolémée chez les Némèdes... Cette affirmation fut mise en crédit par les humanistes rubéaciens Lycostenes (Conrad Wollfhard) et Pellicanus (Kürschner) au 16e siècle. D'après eux, « Rufach, très ancienne ville d'Alsace fut bastie par les Romains l'année seconde de la 235ème Olympiade, l'an 914 depuis la fondation de Rome (164 après J.C.), sous le consulat de Junius Rusticus et de Vatius Aquilinus du temps des empereurs Marc Aurel et Verus. Ceste ville..., a esté longuement la retraite de la noblesse romaine qui y a habité près de 500 ans ».
On pouvait admettre que ceci était le fruit de l'engouement des humanistes pour l'antiquité, mais il est tout de même curieux que ces 500 ans ajoutés aux 165 de la date indiqués nous portent au milieu du 7ème siècle où la région de Rouffach a été donnée à l'Eglise.
Quoiqu’il en soit de ces considérations, elles constituaient un ensemble d'indications qui convergeaient toutes et qui se trouvent renforcées par les importantes découvertes faites depuis quelques années et surtout au cours des derniers mois grâce à la vigilance de l'archiviste, M. Paul Faust, et au dévouement d'un groupe de jeunes de la Société d'Histoire, de l’école d’Agriculture, sans oublier la collaboration précieuse et avisée de la municipalité.
M. Faust connaît la topographie des lieux comme nul autre, et il est sur les traces d'une délimitation bien définie du plus ancien centre culturel de la cité, Il nous en parlera dans nos prochaines éditions.
Hugues WALTER
(à suivre)
Notes:
[1] SCHLUMBERGER, Jean, Cäsar und Ariovist, oder Versuch den Ort zu bestimmen wo Ariovist von Cäsar geschlagen wurde, Colmar, 1877.
[2] BÜTTNER Heinrich (1908-1970) Geschichte des Elsass réédition en 1991 de l’ouvrage de Heinrich Büttner, Geschichte des Elsass, datant de 1939